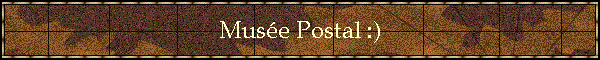
|
|
|
Le Musée Postal des anciens ambulants de Toulouse est installé dans quatre wagons-poste stationnés en gare SNCF Toulouse-Raynal.
Le Musée voyage aussi. Chaque fois que cela est possible ceux des wagons du musée, intégrés au train spécial de l'ACPR 1126 tracté par la locomotive 141R, effectuent des voyages souvenirs. Des liaisons avec Cerbère, Bordeaux, Limoges, Capdenac, Ax-les-Thermes, Sète, Collioure ont déjà été réalisées.
Les bureaux de poste ambulants à Toulouse (1857-1994), fonctionnant dans ces wagons, d'abord rouges puis jaunes, que l'on voit accrochés aux trains de voyageurs disparaissent progressivement, victimes de plusieurs facteurs : cohabitation difficile avec les trains de voyageurs, de plus en plus rapides, avec des arrêts de moins en moins nombreux et de plus en plus courts ; concurrence de l'avion et, surtout, du tri automatique du courrier. Ces services auront fonctionné, en France, pendant 150 ans.
Cette histoire est connue surtout par les marques postales, empreintes de timbres à date ou de griffes sur les correspondances, appelées aussi cachets : elles témoignent de l'existence d'un service entre deux dates, le service ayant ; pu être créé un peu avant ou avoir disparu un peu après ; il a pu aussi y avoir des interruptions. Les archives administratives ont généralement disparu. D'où un certain flou, mais on peut cependant dégager l'évolution d'ensemble.
A Toulose, comme ailleurs, le courrier postal fut transporté, dès leur origine, sur toutes les lignes de chemin de fer, aussi bien celles de la Compagnie du Midi (aujourd'hui SNCF), que celles de la Compagnie des Chemins de fer départementaux du Sud-Ouest, aujourd'hui disparues.
Sur les lignes à faible trafic ou courtes (notamment sur celles des chemins de fer départementaux), le courrier fut d'abord transporté dans de simples coffres, puis accompagné par un agent de la poste, le courrier-convoyeur. De même sur les trains omnibus.
Sur les lignes principales et avec les trains rapides, on mit en service des bureaux de poste ambulants. Ces bureaux effectuaient un parcours aller, à partir de la résidence administrative du personnel, appelé "la descente" (par exemple de Toulouse à Limoges), puis un parcours retour appelé "la remonte" (par exemple Limoges-Toulouse).
Parfois, deux ou plusieurs services de bureaux de poste ambulants étaient organisés sur la même ligne, à des horaires différents, souvent un service de jour et un service de nuit (appelés "primo, 1°", "secundo, 2°'; etc ...). Cela était lié au fait qu'il y avait autrefois, dans les villes, deux ou plusieurs distributions quotidiennes de courrier.
Il est impossible (et il serait fastidieux) d'énumérer toutes les créations, modifications ou suppressions de services intervenues depuis l'origine, en 1857.
La mise en service de bureaux de poste ambulants a nécessité la construction de wagons spécialement aménagés à la fois pour le tri et pour le confort, bien rudimentaire au début, du personnel. Il y eut successivement plus de 20 modèles de wagons-poste, avec des variantes selon les compagnies. Parmi eux, lesquels ont pu venir à Toulouse ?
A l'origine, en 1857, les wagons étaient entièrement en bois, châssis et caisse, à deux essieux, d'une longueur d'environ 7 mètres, d'un poids total en charge de l'ordre de 10 tonnes. Ce type de wagon était encore en service à Toulouse vers 1907, selon Jean Tornadre : "on utilisait alors des wagons de bois. Ils avaient deux portières au milieu. Leur couleur était rouge brique et leur forme ne différait guère de celle des voitures de voyageurs qui, elles-mêmes, rappelaient le profil des diligences". En cas d'accident grave, de tels wagons ne résistaient pas aux chocs et se disloquaient.
Aussi, à partir de 1900, l'Administration mit progressivement en service des wagons à châssis métallique rigide, mais à caisse encore en bois, à deux essieux, d'une longueur d'environ 14 mètres, d'un poids de l'ordre de 20 tonnes et aussi des wagons un peu plus longs (18 mètres), à deux boogies, d'un poids de l'ordre de 30 tonnes.
Il y eut aussi, autour de Toulouse, des « petits ambulants » n'occupant qu'une partie du wagon. Le reste du wagon était aménagé en compartiments de voyageurs.
Plusieurs accidents ayant montré le danger que présentaient encore ces wagons à caisse en bois, l'Administration mit en service, à partir de 1924, des wagons à châssis et à caisse métalliques, à boogies, de 20 à 22 mètres de long, d'un poids de l'ordre de 50 tonnes. Des wagons dérivés de ce type sont encore en service.
Depuis 1971, on a vu circuler des wagons longs de 26 mètres, d'un poids de l'ordre de 48 tonnes, beaucoup mieux adaptés, par leur aérodynamisme et leur suspension aux grandes vitesses.
Bien entendu, le confort et la sécurité pour le personnel se sont améliorés d'un modèle à l'autre, en même temps que les performances techniques. Mais la disposition générale de l'espace de tri est restée la même.
Et l'ancienne couleur extérieure, rouge foncé, a laissé place aux couleurs actuelles de la Poste, avec lettres en bleu sur fond jaune.
Dès l'origine, le réseau des lignes des bureaux de poste ambulants fut, bien sûr, calqué sur celui des Compagnies de chemins de fer. Ainsi furent créées en 1854, sept directions à Paris (Nord - Est - Centre Sud-Ouest - Lyon - Ouest - Nord Ouest.) plus deux en province : la direction de la "ligne de la Méditerranée", à Marseille, et celle de la "ligne des Pyrénées", à Bordeaux.
Depuis l'origine aussi, des locaux sont réservés dans les gares, d'abord, à l'entreposage des sacs (les entrepôts), mais aussi, en bouts de lignes, là où c'était nécessaire, des locaux pour la gestion administrative d'un "service centralisateur des ambulants", et pour le dépôt du matériel utilisé sur les wagons (les sacs de brigades) et pour le repos du personnel entre deux voyages (ces derniers locaux ont disparu depuis que l'octroi au personnel de frais de voyage lui a permis d'aller en dehors des locaux administratifs.).
Très petits à l'origine, ces locaux durent être agrandis en raison de l'accroissement du trafic et donc du personnel. On dut les sortir des bâtiments des gares pour être installés dans des bâtiments, spécialement construits pour que le tri du courrier postal y soit assuré par un nombreux personnel sédentaire :"les bureaux-gares".
A Toulouse, un bureau-gare postal est attesté à la gare Matabiau en 1898 ; il pouvait exister avant. D'abord rattaché administrativement à la Recette Principale, il fut érigé en "Centre de Tri Postal" autonome, le 16 octobre 1909. Peut-être fut-il installé tout d'abord dans un premier et tout petit bâtiment, celui que l'on voit sur plusieurs photographies prises vers 1900, à gauche du pont dit de l'Ecole Vétérinaire ? Il est sûr qu'il fut ensuite installé dans le bâtiment qui subsiste actuellement au même emplacement, construit en 1909, agrandi vers la gare en 1947, puis abandonné par la Poste et cédé à la SNCF en 1962. En effet, cette année là, on mit en service le bâtiment actuel.
Il paraissait très grand, comparé à ses prédécesseurs. Mais aujourd'hui il n'abrite plus que le transbordement au niveau des quais SNCF, et divers services dans les étages. L'essentiel du tri se fait dans les nouveaux et beaucoup plus grands "Centres de Tri automatique" construits à la périphérie de Toulouse, à Lardenne (pour les lettres), et à Lalande (pour les paquets).
Une équipe, de l'ordre de 5 à 10 hommes, "la brigade", travaillait sur un wagon-poste. La plupart d'entre eux effectuaient la totalité du parcours. Mais, parfois, certains n'en effectuaient qu'une partie à la descente et remontaient avec une autre brigade : ils étaient à cheval sur deux (parfois trois) services, d'où leu nom de "chevaux" (parfois "chevaux triangulaires" ! ...).
Les conditions de vie et de travail étaient, évidemment, très particulières, pour une équipe emportée au loin dans une caisse roulante et composée des mêmes personnes à intervalles de jours réguliers. Pour les évoquer voilà un emprunt de quelques passages du récit d'un ancien ambulant sur Toulouse-Limoges et retour :
- Toulouse Gare Matabiau - vers 19 heures. L'effectif de la brigade est d'environ 20 agents, répartis sur plusieurs wagons. On embarque "ambiance de vestiaire ou de chambrée de régiment : à l'intérieur, on se change". Réception des sacs de courrier, empilés en bon ordre - puis ouverture des sacs et début du tri, le train restant à quai.
- Minuit quinze : le train démarre pour la "descente" vers Limoges. Le tri continue.
- Vers 1 heure du matin, après Montauban, c'est la pause : casse-croûte, conversation sur des sujets divers, rires, parfois chansons : "réunion qui permet au groupe de se rapprocher, d'entretenir et de raffermir les liens qui unissent la petite équipe".
- 1 heure 37 - Cahors - fin de la pause - chargement de nouveaux sacs. Le tri reprend : "quasiment muette, la troupe s'affaire : il faudra livrer à l'heure à Brive ; la course contre la montre a commencé".
- 2 heures 47 - Brive - Echange de sacs en gare - Ouverture des nouveaux sacs et reprise du tri : "on entendrait une mouche voler ; la fatigue gagne petit à petit".
- vers 3 heures 45, fermeture des sacs à livrer, puis changement de tenue.
- 4 heures : arrêt à Limoges - Bénédictins. Echange de sacs - la brigade quitte les wagons, qui continueront vers Paris avec une simple escorte. Café-croissant dans un bar, puis chacun va se coucher, à l'hôtel ou chez l'habitant.
- en fin de matinée, réveil. Puis, il faut passer le temps, à Limoges ou dans les environs, entre les repas : tourisme, piscine ou baignade dans quelques lacs, tennis, pétanque, jeux de carte, baby-foot, cinéma ... selon le temps et les goûts de chacun.
- vers 21 heures, retour dans un wagon-poste pour la "remonte" vers Toulouse. Les sacs, cette fois, contiennent beaucoup de journaux venus de Paris. Comme à l'aller, se succèdent chargement et déchargement de sacs aux gares, ouverture, tri, fermeture, pause, reprise du travail, etc...
- vers 4 heures 15, arrivée à Toulouse, où tout doit être descendu des wagons : sacs de courrier et matériel de la brigade : "rapidement, des poignées de main et les gars se donnent rendez-vous pour le surlendemain, pour deux nouvelles nuits. Ainsi, la boucle est bouclée. Dans une demi-heure, une heure ou même deux, suivant qu'ils habitent à Toulouse, Albi ou Carcassonne, ils se glisseront dans leurs draps".
- Les ambulants recréent un univers parallèle. Les vertus du groupe y sont cultivées dans un esprit de clan, de deuxième famille. Le "wagon" est leur deuxième foyer.
Parfois, hélas ! des accidents. Tel le déraillement de Najac, dans la nuit du 15 au 16 juillet 1891 : wagon-poste en bois, renversé et brisé : quatre postiers sérieusement blessés.
Tel aussi le choc du 31 août 1985, à Argenton-sur-Creuse déraillement d'un train de voyageurs Paris-Toulouse, dans une courbe, heurté ensuite par le train postal Toulouse-Paris : 43 morts parmi les voyageurs, et quelques blessés parmi les postiers.
Ainsi vivaient ceux que l'on appelait : « les seigneurs de la Poste ».
Pour agrandir, il suffit de cliquer sur les photos :) |