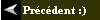
L'immeuble qui s'ouvre par un
portail cintré au 13 de la rue de la Pleau abrite le musée Paul-Dupuy derrière
une haute et austère façade de briques. Proche de la place des Carmes, ce
quartier aux rues étroites mais passantes conserve un incontestable charme.
L'architecture des siècles passés y a laissé de nombreux témoignages de sa
splendeur malgré la mutilation infligée en 1908 par le percement de la rue
Ozenne.
Lorsqu'en 1905 Paul Dupuy acquit l'hôtel dit de Pierre Besson (qui fut le
procureur à la Cour dans la première moitié du XVII° siècle) celui-ci n'était
plus qu'une vieille bâtisse délabrée. Homme de goût, Paul Dupuy entreprit alors
une intelligente restauration de la demeure qu'il destinait à ses collections.
II fit surélever l'ancienne construction, la coiffa d'un étage de mirandes, fit
achever la tourelle capitulaire dans l'angle de la cour et redonna à la façade
le rose de son appareil de briques. L'écrin était superbe. II reçut les
collections dont l'importance et la diversité firent de ce musée privé "le Cluny
de la Ville rose" (Ch. Bernardin).
Evoquer la personnalité de Paul Dupuy éclairera le visiteur que l'accumulation
de ces richesses ne peut manquer d'étonner.
Né à Toulouse le 10 janvier 1867, Paul Dupuy appartenait à une famille de grands
négociants en épices qui fit fortune dans l'exportation du cornichon abondamment
produit par la région. Ayant sans doute peu d'attrait pour le commerce, il fit
de solides études et devint ingénieur civil de l'Ecole Centrale, laissant à son
frère Alfred la direction des affaires familiales. Sa fortune le dégageant de
toute contrainte matérielle, il put se consacrer à ses goûts. Collectionneur,
bibliophile, amateur d'art, il fut avant toute chose un fervent du passé
toulousain. Demeuré célibataire, Paul Dupuy s'éteignit le 11 décembre 1944. II
léguait à l'Etat, qui les rétrocédait à la Ville, l'hôtel de la rue de la Pleau
et ses collections.
Ainsi, Toulouse doit à ce passionné
l'un des plus extraordinaires ensembles de documents et d'objets, témoins d'un
passé proche ou lointain, liés à l'histoire de la région toute entière. Au
lendemain de la seconde guerre mondiale s'ouvrait une ère nouvelle qui allait
voir appliquer de grandes mesures salutaires au patrimoine culturel. Les musées
ne restèrent pas à l'écart, et Paul-Dupuy bénéficia des tout derniers progrès de
la muséographie, devenant un modèle du genre. C'est à Robert Mesuret, premier
conservateur, que revint la délicate mission d'assurer la nouvelle présentation
des collections. L'inauguration eut lieu le 14 juillet 1949. Pour de longues
années, le musée devint l'un des centres d'attraction de la vie culturelle
toulousaine. Préconisés par la Direction des Musées de France, des échanges et
des dépôts entre musées et bibliothèques avaient permis un regroupement de
certaines collections. De cette action naquit le Cabinet des Estampes,
aujourd'hui le fonds le plus important de documents graphiques sur la ville et
la région, auquel font appel historiens, étudiants ou simples amateurs. Au
Cabinet des Estampes s'adjoint une bibliothèque spécialisée riche de plusieurs
milliers de volumes, du XVIII° siècle à nos jours.
Quant aux collections d'objets, leur diversité est si grande qu'il serait
fastidieux de les énumérer. Disons pour mémoire qu'elles vont du bouton
d'uniforme aux meubles anciens, en passant par la faïence, l'orfèvrerie,
l'horlogerie, le costume, les armes, la numismatique, la ferronnerie, etc. Elles
recouvrent une vaste période, du Moyen Age au XIX° siècle, ce dernier étant
particulièrement bien représenté. Au legs de Paul Dupuy et au don d'Edouard
Gélis (collections majeures) sont venus s'ajouter de nombreux dons et
acquisitions. Parmi les plus importants, citons la collection Rozès de Brousse
(dessins, gravures, affiches), la collection Regraffé de Miribel (gravures).
Mais dons et acquisitions posaient rapidement des problèmes et, tel qu'il se
présentait, le musée Paul-Dupuy était dans une situation précaire. Dans les
locaux exigus des réserves, s'entassait une impressionnante quantité de pièces
jugées secondaires que seules des expositions temporaires permettaient de
montrer, et dans les salles d'exposition, la présentation non dépourvue de
charme paraissait réserver ses plus beaux objets aux connaisseurs.
Depuis les années soixante, une extension était apparue nécessaire. Elle fut
rendue possible par l'acquisition, en 1968, d'un immeuble contigu au musée, au 8
de la rue d'Aussargues. Ce bâtiment aurait été construit après 1731 pour le
substitut du procureur général Jean de Raymond. Dès lors, la rénovation que la
Ville avait décidée pour l'ensemble de ses musées fut arrêtée pour le musée
Paul-Dupuy. De 1980 à 1985, d'importants travaux redonnèrent une seconde
jeunesse à l'architecture intérieure que des transformations successives avaient
profondément altérée. Peu d'éléments authentiquement anciens subsistaient : le
parti fut pris de donner aux nouvelles salles un cadre discrètement évocateur de
l'hôtel particulier.
La visite débute au second étage par un programme audio-visuel retraçant
"l'histoire de la mesure du temps" qui précède la présentation de la donation
Edouard-Gélis, composée d'horloges, montres et automates du XVI° au XIX° siècle.
Des instruments de mesure du temps non mécaniques (astrolabe, cadrans solaires,
etc.) complètent la collection.
Au premier étage une salle abrite
les collections de poteries vernissées, parmi lesquelles des pièces régionales
du début du XVII° siècle (Giroussens, Puybegon, etc.).
Le visiteur pénètre ensuite dans le "salon de musique", où ont été regroupés du
mobilier, des instruments de musique anciens, de l'orfèvrerie et des miniatures.
Suivent les salles de faïence stannifère produite par les fours toulousains et
régionaux (1° salle) et les autres grands centres français (Bordeaux,
Montpellier, Moustier, Marseille, Nevers, Strasbourg, etc.) (2° salle) où six
vitrines renferment des pièces de verrerie et de porcelaine.
Le rez-de-chaussée est principalement consacré au costume et à ses accessoires
(XVIII° - XIX° siècle). C'est dans la plus grande salle de ce niveau qu'est
présentée la "pharmacie des jésuites", oeuvre des ébénistes Louys Béhori (1632)
et Jean Escoubé (1663), avec les vases de pharmacie (faïences des XVII° et
XVIII° siècles). Le très célèbre vase à thériaque, millésimé 1624, en étain
gravé et le diplôme d'apothicaire de Jean Mosé (1656) en sont les pièces les
plus précieuses.
Trois salles voûtées à l'appareil de briques occupent le sous-sol.
La première est dite "d'art sacré". C'est là que sont regroupées les pièces
liturgiques et les pièces qui participaient à la décoration des églises ou de
leurs chapelles (sculptures, ivoires, émaux, orfèvrerie et le grand parement
d'autel des Cordeliers, broderie datant de 1320, récemment restauré à la
Fondation Abegg de Berne, étudié par Monsieur le professeur Marcel Durliat).
Les armes et la ferronnerie occupent les deux autres salles.
De plus, le musée Paul-Dupuy présente régulièrement des expositions temporaires
dans les salles spécialement aménagées.
Une salle de conférences et de concerts en fait enfin un lieu bien vivant qui a
repris sa place dans la vie culturelle toulousaine après cinq longues années de
fermeture.
Pour
agrandir, il suffit de cliquer sur les photos :)
