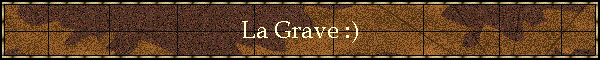
|
|
|
On ne connaît pas la date de fondation de l'Hôpital de La Grave. Il est entré dans l'histoire de Toulouse peu à peu. Il est souvent question à son propos d'une charte de Raymond VI, datant de 1197, dont l'existence est contestée par les historiens. Arnaud d'Avignonnet le cite dans son testament de 1398 parmi les établissements hospitaliers de Toulouse.
Les tours de la ville ont été les premiers lieux d'éloignement et, parmi elles, la tour dite des pestiférés est signalée dans l'hôpital de la contagion, rive gauche. Les bâtiments de cet hôpital nous sont inconnus, probablement pauvres, en bordure du fleuve, comme d'autres "charités".
Les épidémies de peste sont fréquentes, meurtrières. Pendant le XVI° siècle on va compter onze épidémies, et en 1506 trois mille toulousains sont morts de peste. Les capitouls décident, en 1508, de construire un hôpital "pour les pestiférés pauvres, en bordure de Garonne". Près de l'enceinte fortifiée de la ville, les bâtiments sont élevés entre 1508 et 1544. C'est
l'hôpital Saint-Sébastien, et il est vite insuffisant.
A partir du XVII° siècle l'hôpital cesse de fonctionner pour les pestiférés. Les donations et legs se raréfient, et surtout, sous l'influence de Vincent de Paul et de ses émules sa vocation va être transformée. Arnaud Baric, l'Abbé de Ciron et Madame de Caulet organisent l'assistance aux
pauvres, créent une aumônerie générale, dédient l'hôpital aux mendiants, aux
enfants trouvés, aux invalides. Il faut pour cela transformer l'hôpital Saint-Sébastien en
Hospice Général, comme à Paris, afin d'y loger les mendiants.
Après 1660 l'hôpital devient la propriété de ses Directeurs, lesquels créent, dès 1661, leur conseil de gestion des biens, comme à l'Hôtel-Dieu. Des constructions commencent en 1661, jusqu'en 1664. Certaines persistent de nos jours dans les bâtiments bordant les cours les plus anciennes de l'hôpital. En 1687 un incendie les détruit en partie, et l'hôpital inachevé, traversera le XVIII° siècle sans grand changement. L'esprit, la vocation donnée à l'Hôpital Général font que l'on y interne d'office pour pauvreté, infirmité, vérole, vieillesse, folie, avec les malades mentaux incapables de se conduire seuls, les femmes de mauvaise vie et les "maquerelles punies par la mouillure".
Monseigneur Henri de Nesmond, Archevêque de Toulouse, a voué sa vie aux pauvres. Sous son impulsion, pour trouver l'argent nécessaire au fonctionnement de l'hôpital St-Joseph, les Directeurs organisent une loterie très administrativement conduite et décident de la construction d'une nouvelle chapelle, en 1719. La première pierre sera posée en 1758. Peu à peu tout ce qui restait de l'ancien hôpital des pestiférés disparaît, les grandes cours carrées sont de nouveau en chantier. La Révolution n'a pas interrompu cette politique de restauration, de construction, ni l'affectation et les buts de l'hôpital. Il change seulement de nom, et devient pour quelques années l'Hôpital de la Bienfaisance.
Il n'y a en réalité dans ces lieux aucune salle de malades, sauf de petites infirmeries. Les journées se passent dans les ateliers et les cours bien aérées. Les grandes cuisines alimentent jusqu'à 2 500 indigents. La nuit on les "entasse" dans de grands dortoirs avec des lits à rideaux épais, et même dans les galeries, faute de place. La saisie des biens du clergé, après plusieurs occupations militaires, accorde aux Directeurs de La Grave l'annexion du monastère des Clarisses de St-Cyprien, dites Dames de la Porte, de l'Isle, ce qui double la superficie de l'hôpital. Le couvent, ses jardins, ses bâtiments reconstruits en partie, vont être utilisés pour changer le comportement social et médical envers les aliénés. On ne les enchaînera plus. Ils logeront dans des "cabanons" autour de grandes cours, puis, plus tard, dans des "quartiers" mieux bâtis, sous la double influence de deux médecins célèbres Pinel (1745-1826) et Esquirol (1772-1840).
Le 9 mars 1815 arrivent à La Grave les Filles de la Charité, dont les premières furent Sœur Durgueilh, Supérieure Générale et Sœur Chagny. Elles seront trente religieuses pour les pensionnaires et trois pour la maison des orphelins. Leur nombre ira jusqu'à cinquante en 1866, organisant, dirigeant tout l'hôpital pendant le XIXème siècle. Les bâtiments autour des cours sont achevés, mais ce n'est que la construction de la chapelle et du dôme qui donneront à La Grave l'aspect qui nous est familier, malgré bien des vicissitudes autour de cette lourde chapelle posée dans le lit de la Garonne.
La fin du XIXème siècle transforme l'hôpital en le médicalisant. Il redevient Hospice St-Joseph de La Grave. En
1889, on installe des services cliniques de Gynécologie-Obstétrique. En 1924, on installe les services Oto-Rhino-Laryngologie, et on ouvre deux structures médicales associées : le Centre de Sérologie anti-syphilitique et surtout le Centre Anti-Cancéreux (CRAC). Dans les années 1970-1980, le CRAC qui est très augmenté, devient le Centre Claudius Regaud. Aujourd'hui, l’Hôpital de La Grave, dispose de services de Gynécologie Obstétrique, du centre de Planification et d’éducation familiale, du CECOS Midi-Pyrénées, la FIV, de Consultations de Dermatologie Vénérologie, de Services de Gérontologie, de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, d’un Centre de soins aux toxicomanes. Pour agrandir, il suffit de cliquer sur les photos :) |